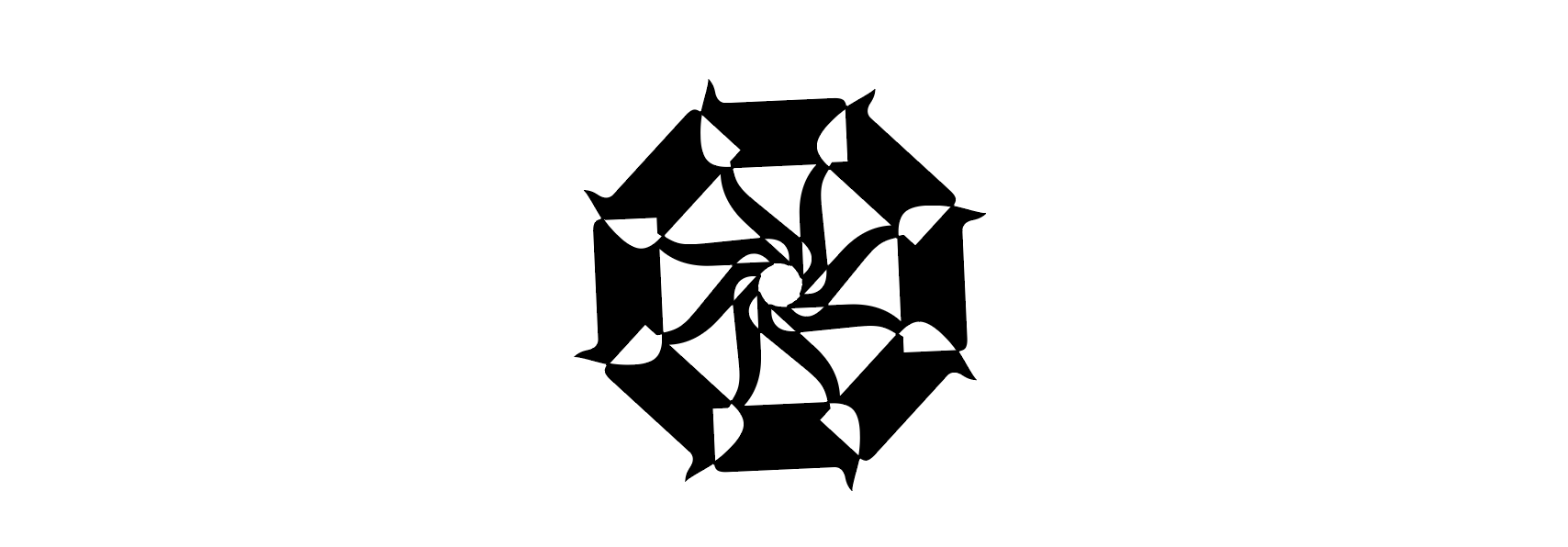Ceci n’est pas un livre sur l’antisémitisme
Alexandre Journo / illustrations : Mathilde Roussillat Sicsic • 25 novembre 2024
La Fabrique nous promet un guide pour lutter contre l’antisémitisme, au singulier, et ses instrumentalisations, au pluriel, celles-ci étant plus nombreuses, et on le verra, plus graves, que celui-là. Il fallait bien la plume experte d’une Houria Bouteldja ou d’une Françoise Vergès pour tenter de laver la gauche des accusations d’antisémitisme. Alexandre Journo a lu pour Daï ce très médiatique pamphlet qui serait risible si l’heure n'était pas si grave. Dans une analyse au vitriol, il offre une lecture critique de ce coup éditorial de la Fabrique, qui prétexte un livre sur l’antisémitisme pour dresser un n-ième procès du sionisme de gauche.
« Dans ce monde sans queue ni tête, pour [lutter contre l’antisémitisme] ce n'est pas directement à l'antisémitisme qu'il faut s'attaquer, mais à l'islamophobie. » On pourrait ajouter : dans ce monde sans queue ni tête, pour vendre un livre sur le sionisme, il faut le présenter comme portant sur l’antisémitisme.
Il y a de bons livres mal titrés. La haine de soi, par exemple, de Theodor Lessing, ne théorise absolument pas ce sentiment de honte que peuvent intérioriser les Juifs devant la pression de radiation antisémite, c’est en fait un livre — excellent d’ailleurs — sur la question juive après l’Émancipation et le problème posé par l’assimilation. Seulement voilà, s’il ne la développait pas dans son livre, Theodor Lessing inventait dans son titre un concept opérant. Il y a parfois de mauvais livres bien titrés, et leur lecture n’en est que plus pénible, parce que l’on espère fébrilement en tirer quelque chose d’intéressant avant de refermer la dernière page. Ce livre-là est un mauvais livre mal titré. Pour qui est au fait de la production éditoriale de La Fabrique, il n’y a rien d’étonnant, mais il vaut mieux le dire en toutes lettres : ce livre ne parle pas d’antisémitisme. Son titre porte le nom d’un concept usé jusqu’à la corde et qui a perdu toute son opérativité, si bien que les auteurs de ce livre ont dû ajouter à leur sacro-sainte « et son instrumentalisation » — ils ne savent pas prononcer le mot antisémitisme sans dire cela immédiatement après — un pluriel « et ses instrumentalisations ». Le seul antisémitisme dont il est question dans ce livre, c’est celui qui est utilisé comme prétexte contre la transformation sociale ou contre les Palestiniens, rien d’autre. Et pas l’antisémitisme sous-jacent, s’il y en a un, mais l’usage des accusations d’antisémitisme. Ma critique pourrait s’arrêter là, puisque la promesse du titre contre l’antisémitisme n’étant même pas honorée, je risque de devoir commenter un hors-sujet — et puis, au vu de cette jurisprudence La Fabrique, annoncer quelque chose dans le titre est le meilleur moyen de l’esquiver. Reste que ce livre risque d’avoir son petit succès à gauche et que ses énormités sur l’instrumentalisation de l’antisémitisme, sur le sionisme et sur la modernité politique méritent d’être examinées.
Le fil rouge du livre est la notion d’instrumentalisation de l’antisémitisme ; instrumentalisation définie comme l’usage de la lutte contre l’antisémitisme à des fins distinctes d’icelle. On comprend rapidement que chez nos auteurs, toute lutte contre l’antisémitisme, toute dénonciation, est instrumentalisation. Pour peu que l’on lutte contre l’antisémitisme, que l’on condamne les auteurs de faits antisémites, alors la lutte contre l’antisémitisme devient utile, affecte le réel et devient dès lors une instrumentalisation qu’il faut combattre. Si l’État combat l’antisémitisme en plaçant des militaires devant les synagogues, en recueillant des plaintes, en poursuivant pénalement les auteurs d’actes antisémites, cela constitue un philosémitisme d’État — et donc une instrumentalisation de l’antisémitisme. Si la droite combat l’antisémitisme alors qu’elle a été complaisante avec cette passion triste par le passé, alors ce combat à droite est insincère et poursuit un autre but, combattons cette instrumentalisation. Seul problème, la sincérité n’est pas un sentiment démontrable. C’est donc une tactique toujours gagnante que de signaler une insincérité et de dénoncer une duplicité. Peu importe que les principaux récipiendaires de ces discours, les Juifs de France, accueillent favorablement cette lutte contre l’antisémitisme. Quand on raisonne avec le prisme de l’instrumentalisation, c’est l’efficacité même de la lutte contre l’antisémitisme qui est condamnée. Lutter contre l’antisémitisme veut alors simplement dire témoigner de l’antisémitisme du monde entier — sauf de Youssef Boussoumah, Jeremy Corbyn et Jean-Luc Mélenchon — et s’arrêter là.
Mais cela ne s’arrête pas là. Il est dans la nature humaine que de projeter ses propres fautes sur ses adversaires, d’être sensible chez l’autre à ses propres travers. Il n’est pas besoin, comme David Guiraud, d’imputer cela à Tsahal seul, « chaque accusation est une confession » est un vieux proverbe que l’on retrouve dans les Pirkei Avot, dans les Évangiles et jusque dans la Recherche. Les auteurs de cet ouvrage instrumentalisent. Oui mais quoi ? L’instrumentalisation de l’antisémitisme. Au motif que l’antisémitisme est effectivement instrumentalisé — au premier chef par l’extrême-droite pour mieux pratiquer une islamophobie acceptable —, au motif aussi que la lutte contre l’antisémitisme, à son corps défendant, a rendu inaudibles les gauches de rupture, de Corbyn à Mélenchon, parce qu’empêtrées dans des affaires bien réelles d’antisémitisme, alors nos amis de la Fabrique instrumentalisent cette instrumentalisation, ne s’intéressent qu’aux conséquences de cette instrumentalisation (et pas à leur déclencheur, l’antisémitisme) dans un but assez précis, faire de l’antisémitisme un non-sujet¹.
Enfin, dernière ligne directrice de ce livre : une critique de la modernité qui confine à la contre-révolution. Tous les auteurs rassemblés là rejettent les apports de la modernité politique : citoyenneté, droits individuels, et portent un regard romantique sur les identités authentiques, aiment la terre charnelle. Ce qui est doublement grotesque : 1. Les derniers et seuls ersatz d’antisémitisme résiduel, ils ne le perçoivent que dans la célébration — confidentielle — de Charles Maurras, le chantre du nationalisme contre-révolutionnaire et professent ce même romantisme national 2. Ils publient leur ouvrage collectif dans une maison appelée La Fabrique et rejettent toute identité qui serait construite par l’histoire. Prenons un exemple. Bouteldja qui souhaite « rendre les Juifs à l’Histoire » a une mémoire bien particulière de l’Ancien régime « où la puissance étatique était relativement faible » et « l’allégeance des différentes communautés était réduite au paiement des impôts » (p. 153). Il était bon, en effet, que l’État ne se mêle pas du sort de la communauté juive de Moselle. Elle était assujettie à une taxe scélérate, la taxe Brancas, à un numerus clausus pour s’installer en ville — ce qui équivalait à un contrôle des naissances —, ne disposait pas de liberté d’installation ni de déplacement, était entravée dans son commerce, soumise à des pogroms réguliers (cf. l’affaire Raphaël Lévy célébrée deux siècles plus tard par Drumont). Mais voilà, elle avait une autonomie collective (en fait, le droit d’établir des tribunaux rabbiniques pour juger des affaires commerciales) et son identité juive authentique n’était pas à la merci de l’assimilation. Et elle ajoute, sans apercevoir là aucun contresens, qu’il était alors aisé de rester juif « parce que les forces sociales et politiques le permettaient » et non par « volonté farouche » et autonome. D’une part, on se demande pourquoi faut-il revenir à cette identité authentique si elle est fabriquée en fait par l’autre, les forces sociales et politiques, d’autre part, on l’invite à lire Tolérance et exclusion de Jacob Katz sur la perception autonome des Juifs comme groupe social propre, leur perception des autres, chrétiens, et l’histoire des relations entre juifs et chrétiens dans la région rhénane — qui ne se limitent évidemment pas à la bonne volonté des forces sociales et politiques et à l'innocuité d’un impôt collectif.
On pourrait en dire à peu près autant des Juifs d’Alsace à la veille de la Révolution. Voilà où Bouteldja veut nous ramener. Voilà ce que préfère Bouteldja à la citoyenneté uniformisatrice. Il y a bien sûr des choses à redire sur l’universalisme républicain et son insensibilité aux différences. Lire Bouteldja ou les autres auteurs de ce recueil peut vous transformer en avocat du jacobinisme tant leur vision du contrat républicain est tronquée et leur pensée contre-révolutionnaire.
Une fois introduite la teneur générale de l’ouvrage, examinons succinctement chacun de ses chapitres. Difficile d’en dégager des thématiques pour décomposer le livre, tous les textes ou presque sont très confus et cherchent à tout embrasser à la fois — sionisme, fondements religieux de l’antisionisme, cause palestinienne et sa répression, gauches de rupture, tout, sauf bien sûr la question de l’antisémitisme. Nous les commenterons donc dans l’ordre du sommaire.
Butler, d’abord. Celle-ci revient sur ses positions de Pantin à l’hiver dernier — quand elle justifiait le 7 octobre (« the uprising of October 7th was an act of armed resistance.[...] This was an uprising [...] You can be for or against armed resistance, you can be for or against Hamas but let’s at least call it armed resistance and then we can have a debate whether we think it’s right ») et remettait en doute les témoignages de viols commis ce jour-là — sans renier quoi que ce soit, déplore les attaques contre la liberté d’expression, devant laquelle l’antisémitisme est peu de choses, dit-elle. Une justification et un déni à la fois. Elle persiste et signe : « la principale motivation du Hamas était de défier une puissance militaire coloniale » (p. 15). Les massacres de Nova, Be’eri, Nir Oz, Kfar Aza sont évacués d’un revers de main. « Une tactique politique, frapper là où cela fait mal ». Une justification et un déni. « Quatre casernes et une rave party » disait Mélenchon sur France Inter le 2 décembre 2023. Si elle veut bien admettre les viols de masse commis le 7 octobre, puisque l’ONU l’a fait, c’est — surprise — instrumental ! pour mieux dénoncer les sévices sexuels commis par Israël dans la prison de Sdei Teiman (p. 16), malheureusement bien réels². Si elle doit qualifier le Hamas de « terroriste », c’est pour l’utiliser aussi contre Israël. Comme dans le syntagme qui ne peut être brisé contre l’antisémitisme et contre son instrumentalisation, où le premier terme est concédé très vite pour ne se concentrer que sur le second, les concessions que fait Butler ici sur le 7 octobre sont aussi instrumentales.
Si elle regrette quelque chose, c’est d’avoir laissé trop de place aux victimes israéliennes dans un texte paru trois jours après le 7 octobre (p. 19). Chez Butler, Israël explique tout, c’est « le point de condensation de tous les problèmes autour de la violence d’État » (p. 7). Butler, pour cette raison, est antisioniste. Elle l’est aussi parce que l’éthique juive, selon elle, commande à la « remise en cause des logiques prédatrices, exclusivistes, coloniales et appropriatives de l’État-nation » (p. 7). Albert Memmi écrit dans la Libération du Juif : « Ce progrès obtenu par et dans l’oppression ne vaut rien. Progrès de vaincus, progrès suspect. » Si l’éthique juive réprouve la force et la domination sur l’autre, quand elle y est contrainte, par la condition minoritaire, on ne peut s’en enorgueillir, notre rôle est au contraire de « refaire » cette éthique souverainement, d’y parvenir en étant responsable de soi-même. Peut-être le sionisme n’y parvient-il pas, empêtré lui aussi dans les schémas mentaux défensifs de la condition minoritaire, mais cet antisionisme juif est très consciemment un moyen d’échapper à ses responsabilités, d’avoir les mains pures sans avoir de mains, selon la formule de Péguy (Victor-Marie Comte Hugo).
Elle est toutefois consciente que le mouvement pro-palestinien est entâché d’antisémitisme, quand on entend sur les campus « Go back to Poland », mais ne fait pas l’effort d’interroger les causes de cette perméabilité à l’antisémitisme. Et puis, écrit-elle, réprimer cette violence verbale est impensable, fût-ce au détriment de la sécurité des Juifs sur les campus. « Conclusion fâcheuse: ma sécurité est plus importante que la liberté d’expression des autres. » (p. 12). Voici la logique fautive des étudiants juifs inquiets de la flambée de l’antisémitisme. Et non seulement la sécurité des Juifs est dérisoire au regard de la liberté d’expression, mais elle est dérisoire aussi au regard de la sécurité des Palestiniens. Expression chimiquement pure de concurrence victimaire, pour se désintéresser de la question de l’antisémitisme. Et si elle admet que l’antisémitisme est condamnable, elle ajoute immédiatement un « mais », « le périmètre de l’antisémitisme a été fortement étendu » jusqu’à ne plus être opérant (p. 13). Pourquoi dès lors condamner un fantôme ?
Pour conclure son chapitre, après une page assez belle, il faut l’admettre, sur les vies palestiniennes et la nécessité de les incarner, d’en faire des récits individuels, elle rend hommage aux victimes palestiniennes de cette guerre et — comme par acquit de conscience, pour se dire qu’elle a bien traité le sujet annoncé — aux « victimes juives du sionisme ». Peut-être la seule véritable mention de l’antisémitisme, qui ne soit pas assortie d’un « mais », il fallait que cet antisémitisme soit le fait… du sionisme.
Le texte qui suit est un poème en vers libres d’Azoulay. Son contenu est proprement délirant et ne mérite pas d’être commenté in extenso — chaque phrase charrie mille fantasmes. Relevons cependant quelques-unes de ses outrances. Azoulay fait elle aussi l’apologie du 7 octobre « L’attaque meurtrière du 7 octobre [...] était un acte de résistance des Palestiniens contre les mille morts qu’elles ont subi depuis 1948 » (p. 28). Elle use à plusieurs reprises de l’expression « nouvel ordre mondial euro-américain », qui est d’ordinaire l’apanage des conspirationnistes. Elle présente la Shoah comme un prodrome à la Nakba, et, si le sionisme = la Nakba = nouvel ordre mondial et, si la Nakba = « l’inscription des crimes sur les corps » = le nazisme, alors l’équation est complète, sionisme = nazisme. L’équation se comprend d’autant mieux que, selon elle, le sionisme a été créé par l’Europe blanche « en vue d’éliminer les juives et les juifs » (p. 29), de brimer « leurs mémoires indisciplinées ». Azoulay semble préférer le témoignage à la vie même, la noble survie mystique à la survie tout court, elle affecte d’être un « problème » au nouvel ordre mondial, enfin, on ne sait pas trop, puisque dans la même phrase, elle « refuse d’incarner les problèmes et les solutions » (p. 48).
Les catégories d’Azoulay sont grotesques, elle est une « juive palestinienne — une espèce presque éteinte » (p. 31), comme si elle était issue du vieux Yishouv et que son identité avait été réprimée par le sionisme. Elle est en fait la fille d’une sabra originaire des Balkans et d’un oleh algérien. Si cette catégorie de juive palestinienne a un quelconque sens, c’est comme catégorie naissante. Plus loin, elle parle de « juifs musulmans ». « Juifs arabes » ne suffisait pas pour effacer l’identité distinctive des Juifs d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (qui se désignent usuellement soit comme juifs tunisiens, algériens, irakiens, etc. soit collectivement comme sépharades ou mizrahim), il faut adjectiver ces juifs par « musulmans ».
Les démonstrations d’Azoulay sont sans queue ni tête : l’Europe chrétienne impose à la fois une homogénéité des Juifs et leur assimilation à chacun des pays où ils vivent, dit-elle, sans ciller, dans la même phrase. Cette assimilation, c’est l’Émancipation, qu’elle présente comme une « première solution », avec un clin d’œil grossier à la solution finale. L’Émancipation, c’est le nazisme ajoute-t-elle p. 38. Dans ce rejet de l’Émancipation civique, Azoulay reproduit involontairement le raisonnement des Penchants criminels de l’Europe démocratique, d’un auteur que pourtant ce petit monde abhorre, Jean-Claude Milner³. Azoulay va toutefois un cran plus loin, l’Émancipation, c’est la colonisation. L’Europe chrétienne invente aussi le sionisme, comme une conversion à une identité chrétienne laïque. Aligner des oxymores provocateurs, des équivalences absurdes, convoquer dans des raccourcis insensés les conquistadors, Napoléon et la ligue antisioniste du Caire, peut-être est-ce une licence poétique, mais cela n’apporte pas grand-chose à un exposé qui ne méritait pas d’être publié.
Arrivé à ce point du livre, la lecture a été exténuante, ce qui dessert les deux chapitres suivants, de Budgen et de Fischer, peut-être les deux de l’ouvrage à mériter lecture. Budgen, d’abord. Il explique que Corbyn a failli apporter une gauche de rupture au pouvoir au Royaume-Uni, et que son ascension n’a été enrayée que par des accusations calomnieuses d’antisémitisme. Les tentatives précédentes de faire échouer ce programme révolutionnaire économiquement et internationalement n’avaient pas été fructueuses. L’antisémitisme a donc été le rayon paralysant contre la gauche. Ou plus simplement un instrument. La première partie de son exposé sur la gauche corbyniste et sur les dynamiques internes à la gauche britannique est intéressante. La seconde partie de ce chapitre n’est qu’un service commandé de défense de Corbyn contre les accusations, nécessairement calomnieuses, contre Corbyn. Pour mieux souligner l’iniquité des procès en antisémitisme menés contre Corbyn, Budgen accumule les titres de presse qui condamnent Corbyn. Ce chapitre ne déroge ainsi pas à la règle : non-sujet de l’antisémitisme, focalisation complète sur son instrumentalisation et ses conséquences (je précise : non pas les conséquences de l’antisémitisme mais des accusations d’antisémitisme) sur la gauche. Quand il s’agit de rapporter la liste des accusations portées contre Corbyn, c’est avec une prudence inégalée : « on prétendit », « on a prétendu que », « on a souligné », etc. p. 63. Le fait rapporté est toujours secondaire devant le discours sur ces faits.
Quelle issue recherchée à la crise pour Budgen ? Sauver Corbyn. Corbyn s’est en effet trompé en faisant des concessions à ses contempteurs… puisque ces concessions n’ont pas payé politiquement et qu’on lui cherche encore des noises. Mais Budgen, par l’intermédiaire de Richard Seymour, vend involontairement la mèche, ces concessions ne pouvaient être sincères puisque tout était « faux et grotesque » (p. 76), des « calomnies » (p. 80). Corbyn s’est encore trompé en ne dénonçant pas assez vigoureusement l’instrumentalisation de l’antisémitisme (p. 78).
Pour une meilleure appréciation du phénomène d’antisémitisme au sein du Labour minoré par Corbyn, puis de l’antisémitisme de Corbyn lui-même, on lira plutôt l’excellente analyse de Milo Levy-Bruhl et Adrien Zirah dans la revue K.
Le chapitre de Fischer, quant à lui, porte sur le rapport des Allemands à Israël, le rôle que joue Israël dans la culture mémorielle allemande, dans la politique de réparation de la Shoah. Ce qui mérite d’être lu. Mais l’analyse de l’antisémitisme est très vite éludée au profit de l’instrumentalisation de l’antisémitisme pour résoudre les flétrissures intérieures des Allemands, pour réprimer le mouvement pro-palestinien. J’exagère un peu. L’auteur dresse bien une histoire de l’antisémitisme, mais ne le voit que sous le prisme de l’État, de l’Église, des junkers (propriétaires terriens), jamais comme un phénomène populaire. Inversement, l’intégration socio-économique des Juifs allemands à la veille du IIIe Reich est perçue comme la preuve de l’absence d’antisémitisme dans la société allemande.
Lorsqu’il s’agit d’analyser l’antisémitisme qui s’est déployé à l’extrême-gauche allemande, dans les années 70 notamment, Fischer commet la même faute que Budgen. Immédiatement après avoir évoqué la Fraction armée rouge et Cellules révolutionnaires (ces dernières étant responsables du raid d’Entebbe), Fischer déplore les « échos de ce récit, considéré sans aucun recul critique, chez nombre de contempteurs des excès actuels de la culture de la mémoire allemande » (p. 102) ou bien « les exemples souvent invoqués du terrorisme de gauche » (p. 103) ou encore « le récit de l’antisionisme antisémite contribue à perpétuer et légitimer la calomnie de l’antisémitisme de gauche » (p. 105). Encore une fois, les discours importent plus que les faits eux-mêmes, et plus les discours se confirment les uns les autres, plus les faits deviennent secondaires devant cette unanimité à condamner. Peu importe sa vérité, c’est sa conséquence emmerdante qui compte, « l’aubaine [pour discréditer] le programme socio-économique de la gauche » (p. 105). Il documente pourtant, peut-être malgré lui, cet antisionisme antisémite.
Il semble même que Fischer n’aborde cette protubérance antisémite de l’extrême-gauche que pour se faire l’arbitre des élégances des discours sur cet antisémitisme. Fischer a peur plus que tout des amalgames : l’attentat du 9 novembre 1969, date anniversaire de la Kristallnacht, contre un centre juif de Berlin-Ouest est condamné pour son amalgame entre Israël et les Juifs, de même que la réponse des autorités, qui « ne remettait pas en cause cet amalgame » (p. 103). Après avoir listé cette litanie d’actes antisémites signés par la nouvelle gauche allemande, Fischer désamorce tout usage de ces informations : « parler d’antisémitisme répandu au sein de la nouvelle gauche allemande est dépolitisant » (p. 103). On connaissait bien le mot instrumentalisation dans la gauche décoloniale. Ce livre permet d’ajouter quelques autres mots magiques : dépolitisant, matérialisme, dynamique, contextualiser, moralisant. Ils ont raison : le meilleur moyen de masquer un tic de langage est de multiplier les tics de langage, pour les diluer. Laissons le dernier mot à Fischer pour conclure, avec la formidable rhétorique du rayon paralysant : « Ce n’est pas pour sa position sur la Palestine que la gauche s’est trouvée sujette aux accusations d’antisémitisme mais plutôt pour sa résistance au statu quo inflexible de l’austérité néolibérale. » (p. 113).
Nous sommes au milieu de l’ouvrage. Comme un entracte, les éditeurs nous proposent un article d’une superficialité rare, mobilisant une soixantaine de notes de bas de page… vers des tweets, pour servir un commentaire d’actualité (sur le sionisme de gauche). La thèse de Benatouil est simple. Le sionisme de gauche est une contradiction dans les termes. Les sionistes de gauche sont pires que les sionistes de droite, parce que leur vernis progressiste les rend convenables. Il y a sans doute une schizophrénie dans le sionisme de gauche, qui consiste à aimer un objet qui déçoit sans cesse, et de continuer à l’aimer malgré cela. Mais je préfère le lire sous la plume réflexive d’Ilan Greilsammer⁴ que sous celle d’un procureur demi-habile. Les sionistes de gauche sont toujours insuffisants pour notre auteur, s’ils dénoncent la guerre, ils valent exactement ceux qui la justifient, s’ils plaident pour la libération des otages, ce sont des « suprémacistes juifs » (p. 127). Benatouil veut que les otages servent d’otages, qu’ils soient effectivement une monnaie d’échange contre les prisonniers palestiniens détenus légalement ou arbitrairement par Israël. Dans sa mise à égalité des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, il y a surtout un refus de la libération inconditionnelle des otages : s’ils ont été pris, il faut bien qu’ils servent. Je m’étonne que cette perversité, commune chez Tsedek, ne soit pas davantage dénoncée.
Suit un service après-vente des déclarations antisémites de Mélenchon, et puis, une épiphanie, un paragraphe démarre par les « 1518 actes ou propos antisémites » recensés en France après le 7 octobre. Notre étonnement est de courte durée. La phrase suivante, et la suite et fin de son chapitre, embraient immédiatement sur leur instrumentalisation par le « bloc bourgeois », qui veut « isoler les juifs du reste de la société ». Suit un long développement sur la marche du 12 novembre, marche vouée à « blanchir les crimes de guerre commis par Israël » (la parole de Mélenchon est vraiment d’évangile). Charitable, Benatouil excuse les « juifs non organisés politiquement [...] d’y avoir participé » (p. 137 ou bien Luc, 23:34) mais charge Golem. Certes, ils y ont participé pour dénoncer le RN. Mais… ils n’ont pas dénoncé l’islamophobie (c’est faux). Mais ils ne se sont pas mobilisés contre la loi Asile et immigration (c’est faux). Mais Arno Klarsfeld a blanchi le RN (et alors ?).
Concluons en apothéose : arrivé aux dernières pages de son chapitre, Benatouil n’avait encore rien dit sur le 7 octobre, et l’on pouvait jouer à prédire si ce serait une justification ou un déni. C’est donc un déni. Il y a « coresponsabilité israélienne dans le 7 octobre » (p. 140) du fait de l’apartheid israélien, dont le déluge d’Al Aqsa n’est qu’une des conséquences mécaniques. Et puis, non seulement le 7 octobre est à moitié imputable à Israël, mais c’est Israël qui en profite (Tsedek aime bien la rhétorique de Lénine, leur dernier grand meeting était intitulé Que faire ?) : « Israël aura de nouveau les coudées franches pour accaparer toujours plus de terres ». Contre le 7 octobre et ses instrumentalisations, pourrait-on dire.
La pièce de résistance, maintenant, Bouteldja. Tachant de se laver des accusations d’antisémitisme qui lui collent à la peau, Bouteldja cherche à démontrer que la lutte contre l’antisémitisme telle qu’elle est menée ne fonctionne pas et qu’il faut donc la remplacer par son logiciel. Par un raisonnement absurde selon lequel elle est la personne la moins antisémite de France – et dont la démonstration ne confirme en rien la validité de ses vues sur l’antisémitisme. Sa thèse, qui n’est rien d’autre qu’une longue provocation, est émaillée de provocations verbales, de clins d’œil grossiers à ses outrances passées, pour faire réagir — à défaut de donner à penser. Tout y passe, être israélien innocemment (« les enfants exceptés » p. 162), le regard qu’elle porte sur l’enfant à la kippa, rendre à Soral ce qui appartient à Soral, Merah ensauvagé. Spectacle pathétique, digne de Marc-Édouard Nabe. Un autre champ lexical de Bouteldja est celui de l’homélie. Son chapitre est ponctué de « Vérité ! », et ses ouailles de la gauche décoloniale écoutent religieusement.
Mais il faut lui reconnaître qu’elle est peut-être la seule à traiter le sujet annoncé par le livre : l’antisémitisme depuis la modernité politique. On l’a vu succinctement dans l’introduction de cette critique, c’est avec un prisme anti-civique et anti-Émancipation, poursuivons. « Dans les États capitalistes avancés, [les juifs] étaient à la merci de tous les vents », à la merci en particulier de la disparition en tant que groupe. C’est effectivement le revers de l’Émancipation civique, mais un revers qu’il convient de tempérer nettement. Clermont-Tonnerre ne demandait pas la disparition des Juifs comme groupe, mais se refusait à leur accorder des droits autres qu’individuels. Les Juifs n’ont pas disparu des îles britanniques après la Bill of Rights de 1689, ils n’ont pas disparu non plus des États-Unis où ils furent citoyens dès leur fondation, ils n’avaient pas non plus disparu de Bordeaux et de Bayonne où ils étaient déjà citoyens (anachronisme pour régnicole) sous l’Ancien Régime. L’Émancipation des Juifs de France en 1791 a été unanimement saluée par les Juifs d’Europe, a été l’horizon politique central jusqu’à l’émergence et le succès du sionisme un siècle, un siècle et demi plus tard. Un siècle et deux siècles après l’Émancipation, les Juifs n’ont pas disparu en France, Adolphe Crémieux était ministre de la Justice en 1848, Léon Blum président du Conseil en 1936, sans qu’ils aient eu à renier leurs adhésions communautaires. Si Bouteldja préfère à cela les pseudo autonomies d’avant l’Émancipation, et celles de la Zone de Résidence en particulier, parce que les Juifs y « gard[aient] leurs spécificités et leur homogénéité » (p. 154), alors il faut la ranger aux côtés de Maistre et de Bonald. « Je pense aux juifs du ghetto accrochés à leur dignité bafouée au prix de la mort » (p. 166) écrit-elle avec des trémolos. Renvoie-nous au ghetto, Bouteldja ! « [Le Juif] doit cheminer vers l’authenticité » (p. 166). Cette authenticité, sous sa plume, est toxique. On ne veut pas revivre la condition juive minorée, et tant pis si l’on est inauthentique. De son exposé sur l’Émancipation, elle tire une leçon très nette : les indigènes ne veulent être les « valets de l’Occident » (p. 159) comme les Juifs ont consenti à l’être en acceptant le contrat de Clermont-Tonnerre. Mais à vrai dire, on ne comprend pas vraiment la prose de Bouteldja, on ne sait si cette offre de subordination est celle de la citoyenneté assimilatrice ou celle du sionisme — qui est le strict négatif de l’assimilation.
S’agissant du 7 octobre, cette fois, il ne s’agit ni d’une justification ni d’un déni — encore que, c’est Israël qui tient la responsabilité du 7 octobre, puisque le massacre du 7 octobre est « la seule forme que lui ont laissé ses bourreaux » (p. 151) — mais d’une interprétation quasi-eschatologique : le 7 octobre, c’est « l’Histoire [qui] se rebiffe » contre les « classes dirigeantes qui voudraient une fin de l’Histoire » (p. 150). Je me permets d’y répondre par un tweet d’Aymeric Morillon : « L'Histoire c'est plus un truc qui broie gens, choses et institutions sur son passage, qu'une divinité qui distribue des brevets de morale en sanctification des conduites. Ce côté "droite de Dieu" dans l'expression "bon côté de l'Histoire" est affligeant de niaiserie mystique. ». Elle ne peut évidemment percevoir aucun antisémitisme dans le 7 octobre puisque l’antisémitisme « n’existait quasiment pas dans le monde arabe » avant 1948 (p. 154), qu’il est aujourd’hui « la plupart du temps une réaction à l’instrumentalisation coloniale ou sioniste » (p. 161). Dix pages plus loin, un peu de déni, tout de même : le Hamas avait des « motivations militaires et stratégiques » à Nova, Be’eri, Nir Oz, Kfar Aza.
Bouteldja explique le sionisme des Juifs maghrébins par un ressentiment à l’encontre des Arabes, du fait précisément de ne pas avoir été leurs victimes comme les Juifs européens ont été les victimes des chrétiens. « Si le frère arabe est honni, [...] c’est parce qu’il est innocent » (p. 161). Ce non-sens est affirmé doctement, mais il n’a bien aucun sens.
Avant de conclure, Bouteldja nous gratifie d’une blague dont elle a le secret. Je la cite in extenso (pp. 167-168).
« Mais tous ces développements n'auraient aucun sens s'ils n'étaient articulés à une proposition. Avant d'aborder ce point, il convient d'évoquer ici une erreur du milieu antiraciste auquel j'appartiens. Celle qui consiste à ne cibler que l'instrumentalisation de l'antisémitisme au détriment de l'antisémitisme lui-même, comme si le second était de moindre importance. Plus qu'une erreur, c'est une faute morale et politique. Aucun combat contre l'instrumentalisation d'un phénomène ne peut aboutir sans lutter contre le phénomène lui-même. Il ne sera donc pas question ici de considérer l'instrumentalisation de l'antisémitisme comme un objectif principal. » (C’est moi qui souligne.)
Épiphanie ! Et quel dommage que les autres auteurs du recueil n’aient pu relire ce chapitre avant d’écrire le leur. Mais elle poursuit :
« Pour mettre fin à l'instrumentalisation, il faut mettre fin à l'antisémitisme, point. Or dans ce monde sans queue ni tête, pour réaliser ce projet ce n'est pas directement à l'antisémitisme qu'il faut s'attaquer, mais à l'islamophobie. ».
Pour préparer une tarte aux pommes, il faut couper les courgettes en lamelles⁵.
Bouteldja décrète doctement que la seule solution à l’antisémitisme passe par la résolution de la question palestinienne (p. 171). C’est quelque chose que je peux tout à fait entendre. Tant que la question palestinienne n’est pas réglée, Israël ne pourra être un État tout à fait normal, et remplir sainement son rôle d’État-refuge, qui coupe l’herbe sous le pied à l’antisémitisme. Seulement voilà, lorsque je le lis chez Bouteldja, j’entends poindre une sorte de chantage. On connaît ce jeu funeste entre Israël et la Palestine. Pas de justice ? Pas de paix disent les Palestiniens et le conflit s’éternise. Pas de paix ? Pas de justice répondent les Israéliens, et l’occupation s’éternise. Bouteldja poursuit ici ce chantage, pas de résolution de la question palestinienne ? Pas de résolution de l’antisémitisme. Pas de résolution de la question palestinienne ? Ne comptez pas sur nous pour faire front contre l’antisémitisme.
Les trois derniers chapitres sont comme le menu du restaurant en ouverture d’Annie Hall (Woody Allen) : « “Boy, the food at this place is really terrible.” The other one says, "Yeah, I know, and such... small portions." ». Vergès propose un texte dont le sujet n’est aucunement l’antisémitisme mais la censure des voix palestiniennes et la destruction culturelle de Gaza, un texte où « l’instrumentalisation de l’antisémitisme » devient une sorte de synonyme de l’État ou du système, un texte dans lequel elle déplore le définancement et l’accusation d’antisémitisme devant une Judensau avec une magen david et la mention du Mossad (une censure scandaleuse de la liberté artistique palestinienne). Lordon un texte qui tient dans son titre : Dominer innocent. C’est impossible, dit-il, bien vu l’aveugle, et c’est ce que poursuit Israël. C’est une vérité générale sur les sociétés humaines, pourrait-on lui rétorquer, deux désirs contradictoires. Aucune société n’a jamais souhaité dominer coupable. Il n’est pas à une contradiction près, puisqu’il écrit qu’Israël « jouit » de la destruction qu’il commet. Je comprenais de son texte qu’Israël se complaisait innocent et détournait le regard de ses propres méfaits. Il jubile à écrire que « les Juifs ne sont pas innocents pour toujours ». Prétendre que les Juifs prétendent cela, c’est un moyen de se décharger de sa propre culpabilité d’Européen, de récuser, la conscience tranquille, la dette de la Shoah. Lordon, comme aucun des autres, n’aborde la question de l’antisémitisme. Pour ce faire, parce qu’il faut quand même mentionner le titre dans chacun des chapitres, il livre entre deux cadratins « — Puisque l’antisémitisme, il y en a ! —» et puis s’en va. Enfin, Klein, à la suite de Bouteldja, livre un prêche sur le sacré et le profane, plein de contresens, d’ailleurs, sur le sens de Pessah, fête internationaliste dit-elle. De toutes les fêtes du calendrier juif, Pessah est peut-être la plus particulariste, celle qui proscrit expressément l’étranger à sa table, celle qui célèbre la naissance d’un peuple. Une fête aussi où l’on rappelle l’héritage d’Abraham sur la terre de Canaan. Certes, nous nous souvenons de la condition de misère, de la condition d’étranger. Mais c’est pour mieux établir une éthique de la souveraineté, de l’accueil de l’autre quand nous sommes souverains, pas pour fuir cette responsabilité et ne pas avoir à l’exercer comme groupe.
Voilà. Nous voilà au terme de ce petit coup éditorial de la Fabrique. Nous l’avons dit dans l’introduction : ce all star de la gauche décoloniale démontre une nouvelle fois, par son obsession de l’instrumentalisation que l’objet premier, en l’occurrence l’antisémitisme, ne les intéresse pas. Nos auteurs font preuve par ailleurs d’un romantisme certain qui leur fait rejeter la modernité civique, guide leur aspiration à une authenticité charnelle. Je ne sais le ranger dans un exotisme malsain pour une judéité perdue par la modernité ou bien plus simplement dans une pensée contre-révolutionnaire. J’avais manqué d’évoquer, néanmoins, deux choses dans l’introduction : dans leurs choix de mots, les auteurs de ce recueil cherchent toujours à déréaliser Israël, les Israéliens ne sont jamais nommés comme tels, mais comme des sionistes. Non pas qu’ils ne le soient pas, mais c’est une manière de créer une distance, de les déréaliser. Comme s’il ne s’agissait que de théoriciens et pas d’hommes de chair et d’os. Et que l’entité sioniste, ou la « colonie sioniste de Palestine » (Azoulay) pouvait être défaite, pour que les Juifs soient rendus à l’Histoire. C’est peut-être un mécanisme psychologique, qui permet de désincarner l’objet de leur hostilité. Peut-être est-ce plus simplement une manifestation de leur déraison : à mesure que les rapports de force sont favorables à Israël, la déconnexion s'accroît davantage et ils estiment Israël plus encore au bord de l’effondrement, alors adviendra leur « paix révolutionnaire » fantasmée. Enfin, un dernier point commun à tous ces chapitres : tous justifient et à la fois nient l’ampleur du massacre du 7 octobre. Si ce livre est un instrument, c’est celui-ci : prendre prétexte de l’instrumentalisation de l’antisémitisme pour justifier les réactions piteuses des auteurs au lendemain du 7 octobre, et persister et signer.
Alexandre Journo est critique et chercheur indépendant. Il écrit sur l’histoire des idées qui ont animé le monde juif, pour les revues Conditions, l’INRER, Daï ou encore Sifriatenou. Ses recherches portent sur la littérature juive, du franco-judaïsme, du problème de l’assimilation, du sionisme et de l’antisionisme. Il est par ailleurs membre du bureau de La Paix Maintenant.
Il fait partie du comité éditorial de Daï.
Voir notamment L’instrumentalisation de l’instrumentalisation ou le piège de l’injonction à ne pas dénoncer l’antisémitisme, JJR, avril 2024
Cf. le travail de Physicians for Human Rights Israel
Cf. la critique qu’en fait Philippe Zard, « L’Europe et les Juifs : Les généalogies spécieuses de Jean-Claude MILNER », in Plurielles, 2004, n°11
Ilan Greilsammer, Un phénomène intéressant: les « amis de “La Paix maintenant” », publié dans l’ouvrage collectif Les intellectuels français et Israël, dirigé par Denis Charbit, aux éditions de l’Éclat.
Blague brevetée par Emmanuel Sanders.